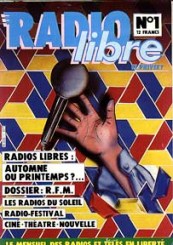 Quand on évoque la métamorphose de l’audiovisuel des années 80, deux évènements majeurs sortent du lot : l’apparition des chaînes de télévision privées, et l’explosion des radios libres.
Quand on évoque la métamorphose de l’audiovisuel des années 80, deux évènements majeurs sortent du lot : l’apparition des chaînes de télévision privées, et l’explosion des radios libres.
En novembre 2011, ce qu’on appelle “la libération des ondes” a fêté ses 30 ans. L’occasion est donc belle de revenir sur cette vague de fraîcheur qui a envahi notre bande FM au début des années 80 !
Ce ne sera peut-être pas du luxe non plus de clarifier les circonstances et les principales étapes de cette libération. Car si on sait que l’émergence des radios libres est intimement liée à l’arrivée de la Gauche au pouvoir en 1981, en revanche, le contexte et le déroulement des évènements reste un peu flou pour les enfants ou ados que nous étions. On va donc tenter de vous décrypter tout ça !!
Quel était le paysage radiophonique avant 1981 ? Pourquoi y avait-il beaucoup moins de radios disponibles ?
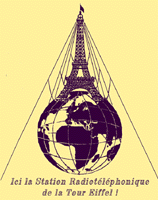 Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir un peu en arrière … trois fois rien, juste une bonne soixantaine d’années ! 😉
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir un peu en arrière … trois fois rien, juste une bonne soixantaine d’années ! 😉
Retour donc dans les années 20 : c’est l’entre-deux guerre, une période de reconstruction … Les moyens de communication se développent, aux premiers rangs desquels le téléphone et la radio. Jusqu’alors réservées à l’usage militaire, les premières émissions radiophoniques publiques sont diffusées en France depuis la Tour Eiffel. L’État ne rechigne pas à partager cette technologie. Ainsi, quelques stations de radio privées sont créées, et émettent en toute légalité. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, où la radio joua le rôle déterminant que l’on sait pour la Libération.
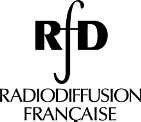 Tant et si bien qu’au sortir de la Guerre, conscient du pouvoir des ondes, le Conseil d’Etat décrète un monopole forcé, interdisant toute diffusion non contrôlée. La radio, comme la télévision quelques années plus tard, doit être la voix de l’État. Nul ne saurait, et ne pourrait, diffuser une parole discordante.
Tant et si bien qu’au sortir de la Guerre, conscient du pouvoir des ondes, le Conseil d’Etat décrète un monopole forcé, interdisant toute diffusion non contrôlée. La radio, comme la télévision quelques années plus tard, doit être la voix de l’État. Nul ne saurait, et ne pourrait, diffuser une parole discordante.
 Dès lors, les seules radios autorisées à émettre sont les radios publiques. La RDF (ancêtre de la RTF puis de l’ORTF) est créée en 1945, et se charge de gérer les organes de communication de l’état : la Télévision (alors composée d’une seule chaîne), et les quelques radios publiques, qui diffusent des programmes thématiques : culture, musique, généraliste … Ces radios prendront au cours des années 50 les appellations encore en cours de nos jours : Paris Inter (qui deviendra France Inter), France Culture, France Musique, FIP …
Dès lors, les seules radios autorisées à émettre sont les radios publiques. La RDF (ancêtre de la RTF puis de l’ORTF) est créée en 1945, et se charge de gérer les organes de communication de l’état : la Télévision (alors composée d’une seule chaîne), et les quelques radios publiques, qui diffusent des programmes thématiques : culture, musique, généraliste … Ces radios prendront au cours des années 50 les appellations encore en cours de nos jours : Paris Inter (qui deviendra France Inter), France Culture, France Musique, FIP …
Qu’appelle-t-on une radio libre ? Quelle est la différence avec une radio pirate ?
 Pour devenir libre, il faut avoir été interdit. Logique, non ? Eh bien les radios libres des années 80 (le terme exact serait plutôt “radios libérées”) sont tout simplement les radios interdites, diffusant des programmes non validés par la RTF, puis par l’ORTF. Avant 1981, en raison de leur illégalité, elles étaient ainsi appelées Radios Pirates.
Pour devenir libre, il faut avoir été interdit. Logique, non ? Eh bien les radios libres des années 80 (le terme exact serait plutôt “radios libérées”) sont tout simplement les radios interdites, diffusant des programmes non validés par la RTF, puis par l’ORTF. Avant 1981, en raison de leur illégalité, elles étaient ainsi appelées Radios Pirates.
Une nouvelle question devrait alors vous titiller :
Si seules les radios publiques avaient le droit d’émettre, pourquoi d’autres radios comme RTL ou Europe 1 sont écoutées depuis plus de 50 ans ?
 Effectivement, de grandes stations commerciales étaient écoutées bien avant la libération des ondes. Car un détail avait son importance : il était interdit d’émettre une émission de radio depuis le territoire français … mais on pouvait parfaitement capter des émissions des pays frontaliers par les Grandes Ondes ! Et oui, si la portée d’un émetteur FM n’est que d’une soixantaine de kilomètres, un émetteur en Grandes Ondes peut être capté à des centaines de km à la ronde !
Effectivement, de grandes stations commerciales étaient écoutées bien avant la libération des ondes. Car un détail avait son importance : il était interdit d’émettre une émission de radio depuis le territoire français … mais on pouvait parfaitement capter des émissions des pays frontaliers par les Grandes Ondes ! Et oui, si la portée d’un émetteur FM n’est que d’une soixantaine de kilomètres, un émetteur en Grandes Ondes peut être capté à des centaines de km à la ronde !
Dès lors, après la Guerre, plusieurs radios s’installent près de la frontière française, et diffusent en toute légalité des programmes en France : la plus connue est bien sûr Radio Luxembourg, depuis le Grand Duché. Elle deviendra RTL en 1966.
En Allemagne, c’est Europe n°1 qui s’installera dans la Sarre en 1955, avec rapidement son émission phare “Salut les Copains”. RMC émettra depuis Monte Carlo, et Sud Radio depuis Andorre.
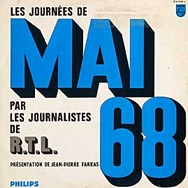 En résumé, ce sont des radios françaises qui diffuseront leurs programmes depuis la périphérie du territoire. D’où leur nom : les radios périphériques. C’est déjà un peu plus clair, non ? 😉
En résumé, ce sont des radios françaises qui diffuseront leurs programmes depuis la périphérie du territoire. D’où leur nom : les radios périphériques. C’est déjà un peu plus clair, non ? 😉
Ces grandes radios cohabitent sans trop de problème avec les radios publiques durant de nombreuses années, le pouvoir gaulliste n’ayant que peu de choses à reprocher aux périphériques, si ce n’est lors des évènements de mai 1968, où RTL et Europe 1 furent accusées d’être la voix des manifestants, et ainsi appelées “Radios Barricades”. Eh oui, ces radios sont aujourd’hui considérées comme les radios de papa, mais à l’époque, c’était elles, les radios jeunes !!
Quand et comment sont nées les Radios Pirates ?
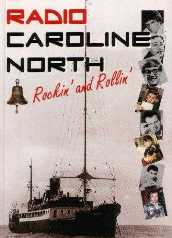 Dans les années 70, la bande FM connaît un bouleversement, avec l’apparition d’étranges programmes, captés au hasard de la molette sur le transistor familial. Le matériel de radio devient abordable, les émetteurs notamment, et il devient un jeu d’enfant, avec un minimum de moyens et de bidouille, de créer ses propres programmes depuis sa chambre, et de les diffuser à son quartier, voire à toute la ville. Bien sûr, de manière absolument illégale.
Dans les années 70, la bande FM connaît un bouleversement, avec l’apparition d’étranges programmes, captés au hasard de la molette sur le transistor familial. Le matériel de radio devient abordable, les émetteurs notamment, et il devient un jeu d’enfant, avec un minimum de moyens et de bidouille, de créer ses propres programmes depuis sa chambre, et de les diffuser à son quartier, voire à toute la ville. Bien sûr, de manière absolument illégale.
La première radio pirate, Radio Caroline, émettait dans les eaux internationales de la Mer du Nord dès 1964, à destination de l’Angleterre, des Pays-Bas, et jusqu’au Nord de la France. C’est sans doute cette pionnière qui inspira la première radio pirate française : Radio Campus à Lille, en 1969. La contagion s’opère, et partout en France fleurissent les premières radios locales. Elles sont parfois des initiatives personnelles d’un jeune bricoleur qui émet depuis son garage pour le fun, mais souvent sont la voix d’associations, de syndicats ou de partis politiques qui revendiquent leur opposition au pouvoir en place.
 Les plus emblématiques sont par exemple “Radio Lorraine Coeur d’Acier”, fondée à l’initiative du syndicat lorrain contre les menaces de fermetures des usines sidérurgiques du Nord-Est, ou Radio Fessenheim, la voix des militants écologiste contre la construction de la célèbre centrale nucléaire. Plusieurs radios à tendance anarchiste émergent aussi, comme “Radio Libertaire” ou “Radio Ici et Maintenant”.
Les plus emblématiques sont par exemple “Radio Lorraine Coeur d’Acier”, fondée à l’initiative du syndicat lorrain contre les menaces de fermetures des usines sidérurgiques du Nord-Est, ou Radio Fessenheim, la voix des militants écologiste contre la construction de la célèbre centrale nucléaire. Plusieurs radios à tendance anarchiste émergent aussi, comme “Radio Libertaire” ou “Radio Ici et Maintenant”.
Et contrairement à ce qu’on croit, les futures radios musicales que sont NRJ, RFM ou Skyrock, n’existent pas encore. Elles n’ont jamais été considérées comme des “Radios Pirates”.
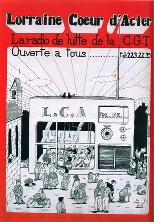 Le pouvoir Giscardien, ne supportant pas ces accès de contestations par les ondes, multiplie les brouillages d’antenne, les confiscations de matériel et alignent les amendes, voire les peines de prison. Cette contestation devient un enjeu national. François Mitterrand en fait un objet de campagne électorale, et promet en cas de victoire à l’Elysée d’autoriser la diffusion de ces radios opprimées.
Le pouvoir Giscardien, ne supportant pas ces accès de contestations par les ondes, multiplie les brouillages d’antenne, les confiscations de matériel et alignent les amendes, voire les peines de prison. Cette contestation devient un enjeu national. François Mitterrand en fait un objet de campagne électorale, et promet en cas de victoire à l’Elysée d’autoriser la diffusion de ces radios opprimées.
Voici une petite vidéo de l’INA pour comprendre le contexte et les grandes espérances des animateurs et créateurs de ces radios libres, datant de mai 1981, juste après l’élection de François Mitterrand :
En attendant, rien ne peut arrêter cette soif d’expression par les ondes, et pour une radio fermée, ce sont deux qui ouvrent ! Pour le plus grand plaisir des auditeurs, qui découvrent un choix pléthorique de radios. Mais au détriment de la qualité de la réception, les fréquences se chevauchant dans un grésillement parfois inaudible. Il est temps de réguler tout ceci, et de réorganiser proprement la bande FM.
Ce sera chose faite dès 1981, avec l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République.

Il tient très vite sa promesse de campagne, et le temps que les textes de lois soient votés, le monopole d’Etat prend fin le 9 novembre 1981. De ce fait, la diffusion de programmes par des radios privées est autorisée. Mais encadrée par une instance de régulation des ondes, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Cet organisme sera chargé de distribuer les fréquences, et pour éviter la surcharge des ondes, décider qui aura le droit d’émettre … et qui ne l’aura pas. Tout ceci de manière (officiellement) impartiale, en respectant le pluralisme et les différents courants d’expression, en fixant la couverture géographique de chaque radio, et diverses normes techniques.
Mais … le combat des radios libres n’en est pas terminé pour autant. Car la loi prévoit la libre diffusion d’émissions de radio, mais à 3 conditions assez restrictives :
– l’interdiction de se regrouper en réseaux,
– l’interdiction d’utiliser des émetteurs trop puissants,
– et surtout le fonctionnement sous forme associative, sans recours à la publicité.
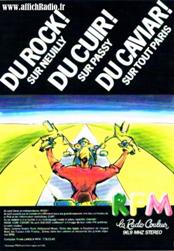 Douche froide pour des investisseurs en herbe, qui avaient flairé la bonne affaire. Car les radios à vocation commerciale ne manquent pas en 1981. Les plus emblématiques sont RFM, ainsi qu’une Nouvelle Radio Jeune, très vite reconnue sous l’acronyme NRJ.
Douche froide pour des investisseurs en herbe, qui avaient flairé la bonne affaire. Car les radios à vocation commerciale ne manquent pas en 1981. Les plus emblématiques sont RFM, ainsi qu’une Nouvelle Radio Jeune, très vite reconnue sous l’acronyme NRJ.
A peine Mitterrand au pouvoir, ces antennes ont pointé le bout de leurs émetteurs, avec l’objectif non dissimulé de faire des ondes un business comme un autre. Les animateurs sont certes bénévoles, mais le matériel et les frais sont importants pour toute station avec un minimum d’ambition.
D’où le recours de plus en plus systématique à la publicité clandestine, par exemple en chroniquant des sorties cinéma de manière pas très objective, ou en matraquant certains disques à l’antenne, en se faisant arroser par les maisons de disques. Et en utilisant des émetteurs de plus en plus puissants, pour toucher plus de monde, quitte à écraser les petites radios locales voisines.
 D’autres radios réellement associatives connaissent de leur côté un âge d’or, une période où la liberté d’expression est reine, et où l’impertinence, voire l’outrancier prennent place. La radio la plus caractéristique de cet âge d’or est la fameuse Carbone 14, à tendance anarchisante, et qui en l’espace de quelques mois révolutionne les ondes et le ton des radios FM. Ce n’est qu’un exemple de cette vague de radios libres et sans concession, qui adoptent une liberté de ton et une indépendance revendiquée. D’autres exemples : Radio Ivre, Radio Tomate ou Radio Aligre.
D’autres radios réellement associatives connaissent de leur côté un âge d’or, une période où la liberté d’expression est reine, et où l’impertinence, voire l’outrancier prennent place. La radio la plus caractéristique de cet âge d’or est la fameuse Carbone 14, à tendance anarchisante, et qui en l’espace de quelques mois révolutionne les ondes et le ton des radios FM. Ce n’est qu’un exemple de cette vague de radios libres et sans concession, qui adoptent une liberté de ton et une indépendance revendiquée. D’autres exemples : Radio Ivre, Radio Tomate ou Radio Aligre.
Pendant 2 bonnes années, la Haute Autorité a du pain sur la planche pour limiter les abus, entre les radios associatives héritières des radios pirates, mal vues en raison de leur ton fort provoquant, et les radios commerciales rusant pour grappiller des parts d’audiences à RTL, Europe 1 et compagnie.
 Ainsi, les mesures restrictives se poursuivent. La Gauche est certes au pouvoir, mais les brouillages d’antenne se poursuivent, et même les descentes de forces de l’ordre. Plusieurs radios se voient saisies et/ou fermées, au premier rang desquelles Carbone 14 fin 1983, remplacée par Fréquence Gaie. Une autre radio se voit retoquée par la Haute Autorité : La Voix du Lézard. Qu’à cela ne tienne, son fondateur Pierre Bellanger se consacrera à la création d’une autre radio : Skyrock.
Ainsi, les mesures restrictives se poursuivent. La Gauche est certes au pouvoir, mais les brouillages d’antenne se poursuivent, et même les descentes de forces de l’ordre. Plusieurs radios se voient saisies et/ou fermées, au premier rang desquelles Carbone 14 fin 1983, remplacée par Fréquence Gaie. Une autre radio se voit retoquée par la Haute Autorité : La Voix du Lézard. Qu’à cela ne tienne, son fondateur Pierre Bellanger se consacrera à la création d’une autre radio : Skyrock.
 Côté radios commerciales, RFM se fait couper son antenne durant plus de 400 jours (!!!) et voit ses émetteurs confisqués, car bien trop puissants au vu de la réglementation. Cette coupure de plusieurs mois a bien failli lui être fatale. NRJ également doit faire face à diverses menaces de coupure d’antenne, la plus frappante étant la condamnation à un mois de silence par la Haute Autorité suite à l’utilisation d’émetteurs non conformes.
Côté radios commerciales, RFM se fait couper son antenne durant plus de 400 jours (!!!) et voit ses émetteurs confisqués, car bien trop puissants au vu de la réglementation. Cette coupure de plusieurs mois a bien failli lui être fatale. NRJ également doit faire face à diverses menaces de coupure d’antenne, la plus frappante étant la condamnation à un mois de silence par la Haute Autorité suite à l’utilisation d’émetteurs non conformes.
Commence alors la seconde lutte des radios FM, beaucoup moins noble que la précédente : celle pour avoir le droit de faire des profits, du lobbying, et de remettre en cause les règles pourtant acceptées auparavant.
 Heureuse chance pour NRJ, sa marraine Dalida a le bras long, et intervient directement auprès de Tonton et son Fabius de 1er ministre pour lever la sanction in-extremis. Revigorée, la station organise alors une manifestation monumentale le 8 décembre 1984, que beaucoup de personnes retiendront à tort comme la manifestation pour les radios libres.
Heureuse chance pour NRJ, sa marraine Dalida a le bras long, et intervient directement auprès de Tonton et son Fabius de 1er ministre pour lever la sanction in-extremis. Revigorée, la station organise alors une manifestation monumentale le 8 décembre 1984, que beaucoup de personnes retiendront à tort comme la manifestation pour les radios libres.
Alors qu’NRJ s’est simplement servi de ses (très nombreux) auditeurs pour servir sa seule cause : le droit de se développer, de constituer son réseau, et d’obtenir une plus grosse couverture. Je ne critique pas cette manifestation, qui a aussi beaucoup apporté à la liberté d’expression médiatique, mais il faut arrêter de croire qu’NRJ a été la radio porte-parole des radios libres et associatives, et qu’elle a participé à la Libération des ondes.

Si on a vu tant de logos NRJ lors de cette mémorable manifestation du 8 décembre 1984, ce n’est pas pour rien : il s’agissait d’une opération de communication parfaitement orchestrée, afin de peser auprès du Gouvernement en invoquant la défense de la liberté d’expression.
 Et Bravo NRJ, car tout a fonctionné au-delà des espérances ! 200 000 manifestants, des soutiens de toute part (Guy Lux, Dalida, Jean-Luc Lahaye, Johnny Hallyday, et même François Valéry !!!). En 1984, sous la pression, l’Assemblée Nationale vote une nouvelle loi pour changer tout ça, ce qui permettra aux radios qui le souhaitent de passer du statut associatif à celui de société. Illico, les premiers réseaux se forment, NRJ en tête.
Et Bravo NRJ, car tout a fonctionné au-delà des espérances ! 200 000 manifestants, des soutiens de toute part (Guy Lux, Dalida, Jean-Luc Lahaye, Johnny Hallyday, et même François Valéry !!!). En 1984, sous la pression, l’Assemblée Nationale vote une nouvelle loi pour changer tout ça, ce qui permettra aux radios qui le souhaitent de passer du statut associatif à celui de société. Illico, les premiers réseaux se forment, NRJ en tête.
Qu’est-ce qu’on appelle un Réseau ? En quoi cela a-t-il changé le paysage radiophonique ?
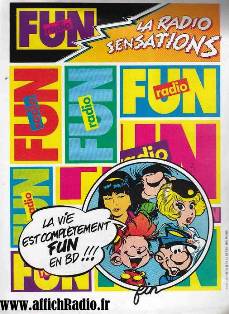 Rapidement, plusieurs radios libres sortent du lot. NRJ prend la tête des audiences, RFM s’affirme en redoutable outsider, et d’autres, dont certaines à présent disparues, se développent à toute vitesse : Nostalgie, Kiss FM, Maxximum, Fun Radio (née de la dissidence d’anciens cadres d’NRJ), Skyrock, etc …
Rapidement, plusieurs radios libres sortent du lot. NRJ prend la tête des audiences, RFM s’affirme en redoutable outsider, et d’autres, dont certaines à présent disparues, se développent à toute vitesse : Nostalgie, Kiss FM, Maxximum, Fun Radio (née de la dissidence d’anciens cadres d’NRJ), Skyrock, etc …
D’autres radios locales ont du mal à suivre le rythme et le professionnalisme des stars de la FM, et n’ont d’autre choix pour survivre que de rejoindre le réseau d’une de ces grandes radios. Avantages pour ces petites radios :
– elles peuvent bénéficier de la renommée et de la communication d‘une grosse station parisienne,
– elles bénéficient de meilleures infrastructures,
– elles profitent des régies publicitaires d’ampleur pour diffuser des annonces.
Pour les “grosses radios”, englober des petites radios locales est aussi tout bénef, car elles récupèrent des fréquences à moindre coût (c’est plus rentable que de créer des studios et de déployer de nouveaux émetteurs), et augmentent leur auditoire en conservant cette notion de proximité.
Mais petit à petit, ces réseaux entraînent la perte complète et irrémédiable de l’âme et de l’identité locale des petites radios. Et ce en plusieurs étapes :
1 – Les radios locales qui rejoignent un réseau gardent leur nom, et se présentent comme tel lors des jingles : exemple : “RMS à Chambray-les-Tours, Réseau RFM” (c’est la radio qui tournait à la maison quand j’étais môme 😉). Elles conservent leurs animateurs et leur grille, tout en diffusant quelques heures par semaine le programme national.

2 – Petit à petit, la proportion s’inverse, avec le déploiement de la diffusion par satellite : les programmes locaux deviennent minoritaire, les pubs locales également, et de plus en plus, le nom de la station change au profit du nom reconnu à l’échelon national, par exemple : NRJ Toulouse ou Nostalgie Nantes.
 3 – Dernière étape, la quasi disparition des radios locales indépendantes : les stations sont totalement mangées par leur réseau. Les programmes locaux disparaissent pour faire place aux programmes parisiens, en laissant très peu de liberté de ton aux animateurs locaux. Rares sont les stations locales à pouvoir lutter contre les grosses radios FM.
3 – Dernière étape, la quasi disparition des radios locales indépendantes : les stations sont totalement mangées par leur réseau. Les programmes locaux disparaissent pour faire place aux programmes parisiens, en laissant très peu de liberté de ton aux animateurs locaux. Rares sont les stations locales à pouvoir lutter contre les grosses radios FM.
D’autant plus que les radios périphériques (RTL, Europe 1…) ont également adopté la diffusion par FM en plus des Grandes Ondes. C’est dire si la concurrence est cruelle.
Le remplacement de la Haute Autorité par la CNCL (Commission Nationale de la Communication et des Libertés) n’arrange rien à l’intégrité de la bande FM. Cet organisme, mis en place en 1986 suite à la victoire du RPR aux législatives, et notamment responsable de la disparition de notre bien-aimée TV6, délivrera les autorisations d’émettre sur fond de scandales et de pots de vin. Les radios associatives, pionnières et héritières des radios pirates des 70’s, sont mises de côté au profit des réseaux.
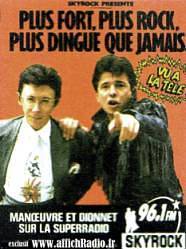 En 1989, le CSA remplace la CNCL, et remet un peu d’ordre dans la jungle qu’est devenue la Bande FM, mais ne peut empêcher sa globalisation … Dans les 90’s, le phénomène des réseaux s’amplifiera, et les groupes de médias fleuriront.
En 1989, le CSA remplace la CNCL, et remet un peu d’ordre dans la jungle qu’est devenue la Bande FM, mais ne peut empêcher sa globalisation … Dans les 90’s, le phénomène des réseaux s’amplifiera, et les groupes de médias fleuriront.
Très vite, ces grandes entités médiatiques se partagent une grosse part de l’audience de la bande FM en absorbant plusieurs ex-radios libres : Radio France (Fr. Inter, Fr. Musique, Fr. Culture, FR. Info, FIP, Le Mouv’ …), la CLT (RTL, RTL2, Fun Radio), NRJ Group (NRJ, Rire & Chansons, Nostalgie et Chérie FM), Lagardère (Europe 1, Europe 2, RFM, Skyrock), Next Radio (RMC, BFM)
Les radios commerciales indépendantes se regroupent à leur tour dans le réseau “Les Indépendants”, pour augmenter leur poids et bénéficier d’une régie publicitaire à grande échelle … Seule Skyrock (rapidement lâchée par Lagardère) demeure un vrai réseau de stations indépendantes “à l’ancienne”.
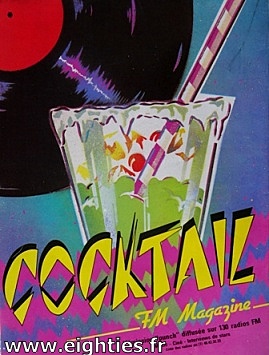 Vous l’aurez compris, l’esprit des radios libres du début des années 80, indépendantes et pleines de fraîcheur, est bien loin !!! Chacune des radios commerciales de notre enfance s’est tour à tour fait happer de gré ou de force par un grand groupe de média.
Vous l’aurez compris, l’esprit des radios libres du début des années 80, indépendantes et pleines de fraîcheur, est bien loin !!! Chacune des radios commerciales de notre enfance s’est tour à tour fait happer de gré ou de force par un grand groupe de média.
A présent, il faut reconnaître que l’ensemble de la bande FM est bien peu varié, et même très souvent désespérant. On y trouve les radios généralistes (RTL, Europe 1, France Inter), les informatives (RMC, France Info, BFM), les radios musicales adultes (RFM, Nostalgie, Chérie FM), les radios djeuns (NRJ, Fun, Skyrock), , les “mi-adultes, mi-jeunes” (RTL2, Virgin (ex-Europe 2), Rire et Chansons).
Dans l’ensemble, ce sont les mêmes grilles de programme, les mêmes tubes fournis par les maisons de disque, savamment testés auprès d’un échantillon de population pour éviter tout accident industriel, le tout généreusement arrosé de pub, de pub et encore de pub, là aussi toujours les mêmes. Il n’est donc pas surprenant de voir le média radio traditionnel voir son audience s’effriter, et le public se tourner massivement vers les webradios, où l’on peut choisir précisément le type d’émission ou de musique que l’on souhaite.
 Cependant, il ne faut pas noircir le tableau, et en cherchant un peu sur la bande FM, régulièrement on tombe sur de belles surprises en découvrant des radios locales drôles, kitsch ou totalement décalées, qui rappellent les belles heures des radios pirate, puis des radios libres, lorsque les animateurs avaient carte blanche pour s’amuser et amuser, sans avoir le couperet de l’audience tombant chaque matin.
Cependant, il ne faut pas noircir le tableau, et en cherchant un peu sur la bande FM, régulièrement on tombe sur de belles surprises en découvrant des radios locales drôles, kitsch ou totalement décalées, qui rappellent les belles heures des radios pirate, puis des radios libres, lorsque les animateurs avaient carte blanche pour s’amuser et amuser, sans avoir le couperet de l’audience tombant chaque matin.
Alors n’hésitez pas à faire un p’tit tour sur la bande FM, et retrouvez l’esprit des Radios Pirates !!!
Pour poursuivre l’aventure des “Radios Libres”, cliquez sur CE LIEN pour découvrir le second article de notre dossier où vous retrouverez de nombreuses stations emblématiques : les pirates, les commerciales, les associatives, les disparues, etc … Vous y trouverez des vieux logos, d’ancien jingles, animateurs … a tout de suite !!!
Et pour découvrir les émissions phares des radios périphériques des années 80, rejoignez-nous dans le 3ème article de notre dossier en cliquant ICI !! 😉



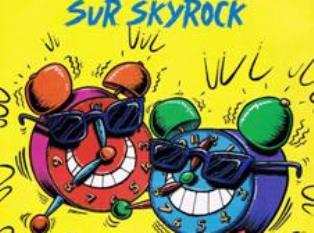
C’est vrai que cette aventure et progression des ondes n’est pas due qu’a NRJ et sa manif! personnellement j’étais + auditeur de RFM. Cela dit , j’écoutais sur NRJ, Bubu et Jean-Marc. Sur RFM Gérard et Sergio. Ce sont les noms dont je me souviens. La radio a bien changé en 2021, c’est vraiment moins humains.